
@catherine hélie, gallimard
Liens vidéos – extraits d’articles
BFMtv, 16 octobre 2023.





Le livre de David di Nota J’ai exécuté un chien de l’enfer. Rapport sur l’assassinat de Samuel Paty est une « contre-enquête » accablante sur le dispositif qui a conduit à l’assassinat de Samuel Paty. C’est une lumineuse et consternante remontée vers la doctrine pédagogique officielle qui a consenti à la série de rumeurs et d’accusations mensongères orchestrée par l’islamisme et l’antiracisme dévoyé qui l’accompagne. C’est un livre poignant, magnifiquement et sobrement écrit aux modes dramatique et narratif.
2 S’y déroule, découpé par les entrées en scène, le scénario « à la fois bienveillant et meurtrier » d’une tragi-comédie politique. Il est fondé sur une doctrine officielle pour laquelle, à la moindre difficulté, une présomption de culpabilité pèse sur le professeur. Il fait voir comment, sur le témoignage mensonger d’une élève qui accuse Samuel Paty d’avoir traité les élèves musulmans de manière discriminatoire, la mécanique du discours victimaire se met en place et s’amplifie, secondée par le dispositif institutionnel : ce qui compte est l’offense ressentie. Mais en quoi un ressenti religieux pourrait-il guider un enseignement laïque ? Cette question centrale est évitée par l’institution, au profit d’un consentement au délit de blasphème.
3 Le fils d’un Tchétchène ayant trouvé refuge dans « l’État français islamophobe », alerté probablement par les vidéos, achète trois couteaux et propose 350 euros à un groupe d’élèves pour lui désigner Samuel Paty.
4 L’assassin suit sa victime. « Nul ne sait si le professeur était encore conscient au moment de sa décapitation ».
5 Un grand sociologue se demande si, avant de blesser les croyants, on ne devrait pas y regarder à deux fois et appliquer nos principes de manière accommodante.
6 Les tombereaux d’hommages officiels et de fleurs ne parviennent pas à dissimuler le contexte institutionnel : « Sans la destitution de l’enseignant et la sacralisation dévastatrice de l’élève, le témoignage de la petite Z n’aurait jamais acquis la moindre importance, pas davantage que le témoignage d’un cancre à l’époque somme toute bénie où l’administration scolaire n’avait pas encore fait du professeur, à la moindre offense ou au moindre malentendu, son fautif idéal. » (p. 94).
7 En se référant à « l’essai prémonitoire » De l’école (1984) dans lequel Jean-Claude Milner décrit l’émergence et les conséquences de ce retournement, l’auteur rappelle le moment où la doctrine scolaire officielle a basculé [1][1]Jean-Claude Milner, De l’école (Seuil, 1984 ; Verdier, 2009)..
8 L’auteur retrace et analyse ensuite l’édifiante histoire de la culture du respect dû aux croyants, introduite par un conte philosophique : « Il était une fois une petite fille très gentille qui ne demandait qu’à être aimée de la société. Malheureusement, cette société était très méchante et ne songeait qu’à la haïr » (p. 99). Il suffit de remplacer « petite fille » par « racisée » et « société très méchante » par « société fondée sur la domination » pour en obtenir la version reçue par les sociologues : le discours victimaire a pour objet de faire passer l’adversaire pour un monstre raciste.
9 Il est naïf de s’interroger sur la vérité de ce discours. Il est vain d’établir la fausseté des accusations qu’il lance. Il faut examiner la source de son efficacité, qui réside dans la question « a-t-on raison d’offenser les croyants ? », d’où suit la maxime : « il vaut toujours mieux apaiser la colère religieuse ». Dès lors la cause est entendue, et il est aisé d’en tirer la conclusion politique sacrificielle : la conception a-religieuse de la laïcité sera une intolérance guerrière, et le retour au délit de blasphème sera qualifié de conception ouverte et apaisante – cela vaut bien une tête.
10 Introduit par la notion d’offense collective, l’appel au respect se soucie peu des individus et des singularités, qu’il s’agit toujours d’enfermer dans un groupe d’appartenance prétendant représenter, fixer et épuiser leur identité. Mieux : cette conception fusionnelle permet de critiquer « l’universalisme abstrait » et sert de cache-sexe philosophique aux idéologies totalitaires. Car « l’antiracisme islamiste n’a pas été inventé pour lutter contre le racisme […] mais pour corriger les effets de l’islamisme par le victimisme » (p. 128).
11 Au prétexte d’une hâtive ressemblance, l’art d’être choqué embrigade indistinctement tout un groupe dans l’identité figée de victime dont il est mal vu de vouloir s’extraire. Son pouvoir s’étend bientôt au corps social qui s’empresse de voler au secours des « stigmatisés » et qui finit par se regarder lui-même au prisme des coalitions identitaires. L’injonction d’appartenance somme chacun de revendiquer une dépendance.
12 On en mesure l’effet par la fréquence croissante de propositions du type « Moi, en tant que Blanc, je pense que… ». Comme si seul un Blanc pouvait savoir ce que ressent un Blanc, un Noir ce que ressent un Noir, une femme ce que ressent une femme. Comme si le respect d’une personne devait se fondre et s’abolir dans le respect d’un ascendant religieux exclusif et jaloux sur les esprits singuliers.
13 À cela, l’auteur oppose justement la richesse de l’expérience littéraire. Parce que la littérature fait de l’expérience singulière une expérience traduisible, parce qu’elle repose sur le principe du dépaysement intérieur – qu’aucun voyage empirique, fût-il dans les étoiles, ne saurait atteindre -, elle est la « négation même du projet communautariste et différentialiste » (p. 145).
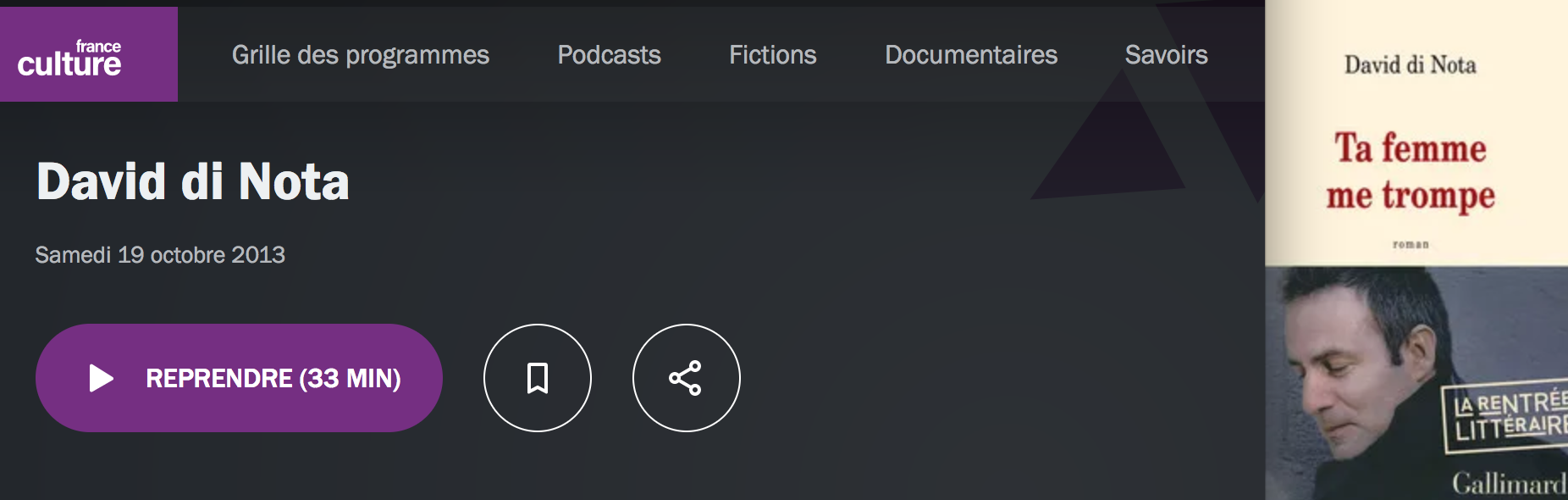
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/du-jour-au-lendemain/david-di-nota-1344306
REVUE PHOENIX, CAHIERS LITTERAIRES INTERNATIONAUX

En ouverture de son livre, David di Nota cite Hanna Arendt : « Qu’est-il arrivé ? Pourquoi est-ce arrivé ? Comment cela a-t-il pu arriver ? ». D’où vient le crime, la décapitation de Samuel Paty, cet enseignant d’histoire sans histoires, le 16 octobre 2020 à proximité de son collège à Conflans-Sainte-Honorine ? D’où vient le mal ? Et de quel mal s’agit-il ? Quelle est son origine ? Quelles en sont ses racines ? David di Nota répond à ces questions, il répond en écrivain, c’est-à-dire qu’il se pose, et pose les bonnes questions, pour tenter d’apporter les bonnes réponses, quitte à ce que ses réponses dérangent et froissent quelques bonnes âmes.
« Comprendre comment un individu se trouve isolé, et finalement pointé du doigt par l’administration dont il relève, constitue certainement la meilleure introduction à ce phénomène peu étudié : non pas le « vivre ensemble », mais le « mourir seul » (Avant-propos, David di Nota).
Il y a d’un côté, ce qui s’est dit sur cet assassinat islamiste, ce qui s’est propagé sur les réseaux sociaux, et puis il y a les faits, qui sont comme on le sait têtus, toujours têtus, et obstinés, écrira Mikhaïl Boulgakov. Les faits, l’écrivain s’en saisit, comme il se saisit du Procèsde Kafka, le roman qui éclaire et accompagne ce livre. C’est le mensonge d’une élève qui est à l’origine de toute cette dramatique histoire, une élève absente du cours sur la liberté d’expression du professeur, mais qui l’accusera de vouloir offenser les musulmans présents dans sa classe, en leur présentant une caricature du prophète, et de demander aux enfants musulmans de sortir, une décision qui dit-elle a choqué tous les élèves. Double mensonge, mais la parole de la collégienne vaudra de l’or, celle de l’enseignant ne vaudra que du vent. La machine est lancée, une enfant au mensonge, un père à la manœuvre, un prédicateur, une vidéo, des messages sur les réseaux sociaux. En substance, il y a dans un collège un professeur raciste et islamophobe, l’administration n’entendra pas, ne voudra pas entendre ce que dira l’enseignant en réponse à ces terribles accusations.
« Samuel Paty n’est ni un saint, ni un martyr, ni un héros, il n’est pas mort pour la liberté d’expression. Il est mort de quelque chose ; et cette chose porte le nom d’une sorte de monstruosité théorique : l’antiracisme islamiste ».
La machine mortifère va s’emballer, comme au temps des procès staliniens. Une machine guerrière islamiste qui s’appuie sur une machine à penser qui se propage, précise l’auteur : un racisme systémique, un continuum colonial, la persécution des musulmans et le rejet de l’islam, des propos, des analyses sociologiques et politiques qui sont dans l’air du temps, comme l’on dit. Samuel Paty sera identifié par le tueur islamiste, montré du doigt par des élèves qui seront payés, la suite nous la connaissons, même si les détails du crime sont oubliés, ou plus précisément rayés de la mémoire collective. Comme est oubliée, ou rayée de la mémoire, la mécanique qui s’est mise en route, bien huilée, pour qu’une parole, pour que les faits qui ont conduit à la décapitation soient ainsi souillés, comme si c’était la tombe de l’enseignant qui l’était avant qu’il ne tombe sous les coups de couteau de son tueur, et ne soit mis en terre.
« Comme si la honte devait lui survivre », écrit Kafka à la toute fin du roman – alors que la lame a déjà pénétré le corps et que Joseph K. est exécuté « comme un chien ».
David di Nota a pour lui la précision, la justesse du propos et des mots, le regard précis sur ce qui s’est passé ; il déroule sous nos yeux les faits et les évidences, l’emballement de la machine, les mensonges, les soumissions, les abandons, les rapports internes, les accusations visant le professeur, tout ce qui alimente l’accusation qui vise Samuel Paty et qui le conduiront à la mort. Ces accusations cousues de fil blanc qui alimentaient les procès staliniens et qui débouchaient, elles aussi, souvent sur la mort. Après le temps de l’effroi, celui du deuil, voici celui des faits, qui ne font oublier ni l’effroi, ni le deuil, mais qui révèlent tous les ressorts du drame, comme chez Kafka. Ce livre pourrait aussi se nommer Le procès intenté à Samuel Paty, sournois, aux mille ressorts, et qui aura raison de ce professeur, tué pour un mensonge, que personne ne voudra dévoiler, une évidence que personne ne voudra voir, et que l’écrivain met en lumière avec la vivacité qui l’occupe lorsqu’il écrit des romans.
« La sentence ne vient pas d’un seul coup, c’est la procédure qui se change peu à peu en verdict » (Franz Kafka).
Philippe Chauché, La Cause Littéraire, octobre 2021.

Un an après l’assassinat du professeur, l’écrivain David di Nota démonte avec une précision redoutable la machination qui l’a broyé.
Avant de publier des romans, David di Nota a écrit une thèse de doctorat en sciences politiques. Ses recherches portaient sur l’action de la Force de protection des Nations Unies (FORPRONU), en Bosnie. En s’intéressant au destin tragique de celui qu’il nomme « le professeur », le parallèle lui a semblé évident. « Comme la FORPRONU, dans l’ex-Yougoslavie, l’Education nationale a voulu jouer aux casques bleus, entre Samuel Paty et les parents d’élèves qui se plaignaient de son enseignement. Plutôt que de la calmer, cette position médiane, ondoyante, a exacerbé la violence. Dans un contexte d’hostilité totale, ne pas prendre une position claire est la pire des solutions. Le mandat de l’ONU a prolongé la guerre et abouti à la destruction de Sarajevo ; les accommodements et paradoxes de l’Institution scolaire, vis-à- vis de la laïcité, ont permis l’assassinat ».
« Crime institutionnel », « barbarie administrative à visage humain », « dictature du respect » : les mots sont durs, le réquisitoire sévère. Son livre n’est pas un récit. Pas tout à fait une enquête, non plus. Il dit « un rapport », se reprend, évoque « un contre-rapport ». « Ce livre est une déconstruction du rapport officiel de l’Inspection générale de l’Education nationale », résume l’auteur. « L’attentat n’est pas un fait divers, l’islamisme ne se résume pas au passage à l’acte d’un fanatique. Pour comprendre le phénomène, il fallait examiner à la loupe la somme de nos lâchetés. En tant qu’écrivain, je me suis senti absolument concerné par le sort de Samuel Paty, qui nous met dans un devoir d’analyse. C’était pour moi la seule façon de lui rendre hommage ».
D’une plume acérée, tout en colère contenue et avec une précision chirurgicale, David di Nota désosse la « mécanique infernale du chantage », le « dévoiement total de l’antiracisme », la mise à mort d’un homme qui voulait « simplement, et honnêtement, faire son travail ». Pour lui qui a fait de la littérature « l’un des grands éléments de compréhension du monde », la référence à Kafka s’est imposée comme une évidence : « Kafka est l’un des grands maîtres du mourir seul, l’un des grands éducateurs de ce broyage qui, à la fin, vous isole totalement. Dans Le Procès, Joseph K. est pris dans les mâchoires d’une machine administrative qui rend toute défense impossible ».
Le Joseph K. de son livre, c’est Samuel P. « Le professeur est accusé d’un crime raciste qui n’existe pas, sur le fondement d’une rumeur fabriquée de toute pièce. Au lieu de le protéger, l’institution prend le parti de le rééduquer et lui demande de s’excuser, pour son bien au nom du vivre ensemble. Puis on lui dit : puisqu’on vous explique votre erreur, c’est que vous êtes le coupable. Cette ambivalence profonde est au coeur du Procès de Kafka. Un faux procès, en réalité. On avait dû dire du mal de Joseph K. puisqu’il a été convoqué ; on avait dû dire du mal de Samuel Paty puisqu’il a été recadré. Dans les deux cas, la machination en a fait des hommes seuls ». A la fin du Procès, deux hommes lui plantent un couteau alors Joseph K. dit : « Comme un chien ». « D’Abdullah, le serviteur d’Allah à Macron, le dirigeant des infidèles, j’ai exécuté un de tes chiens de l’enfer qui a osé rabaissé Muhammad, calme ses semblables avant qu’on ne vous inflige un dur châtiment », a twitté Abdoullakh Anzorov, après avoir décapité l’enseignant aux abords de son collège. Vertigineuses similitudes.
Si le livre de Di Nota est profondément politique, il est aussi l’oeuvre d’un écrivain. « Je ne peux accepter que l’on renonce à enseigner ou jouer Molière parce que ses pièces peuvent choquer un élève. Ce qui est en jeu dans le chantage qui s’est exercé sur ce professeur porte, de façon plus large, sur la culture tout entière. La liberté d’expression, ce n’est pas seulement dire ce qu’on pense ; c’est transmettre ce qui a été pensé. Si on sacralise le sentiment de l’élève, la transmission devient impossible. Avec le blasphème, il n’y a plus de littérature possible ».
Nicolas Bastuck, Le Point, octobre 2021

Charlie Hebdo : Pourquoi « l’école de la confiance », un concept prôné par l’Éducation nationale, a-t-elle une responsabilité dans le crime de Samuel Paty ?
David di Nota : « L’école de la confiance » est une doctrine pédagogique qui définit l’enseignement comme un contrat où les professeurs sont au service des parents et des élèves. L’école n’est plus le lieu d’une transmission de savoir, mais d’une transaction de service. Elle infériorise la position d’autorité du professeur au point que la parole de l’élève est systématiquement valorisée par la hiérarchie. Cette « confiance » est d’autant plus ironique que c’est plutôt « l’école de la suspicion ». Dès les années 1980, Jean-Claude Milner dénonce les dangers de cette « école ouverte » qui favorise « la confusion des pouvoirs », ainsi que « la rumeur familiale dans l’école » et « la rumeur éducative dans la famille »qui mettent en difficulté, pour utiliser un euphémisme, le professeur. Ainsi, au collège du Bois d’Aulne de Conflans-Sainte-Honorine, la rumeur concernant le professeur Samuel Paty est partie d’une élève. Bien qu’absente du cours d’histoire consacré à la liberté d’expression, elle a raconté que Samuel Paty aurait demandé aux musulmans de lever la main et de sortir dans le couloir ; elle serait restée et aurait ainsi vu une caricature de Charlie Hebdo qui aurait « choqué » tous les élèves. Mais la rumeur a aussi gonflé à l’intérieur de l’établissement. Jusqu’au dernier jour, donc durant deux semaines, des élèves, mais aussi des collègues, ont repris la thèse de l’élève menteuse.
Que révèle le rapport officiel de l’inspection générale sur l’assassinat de Samuel Paty ?
Il tresse les louanges de tous les agents de la chaîne académique et il révèle surtout combien l’institution a perdu tout sens moral. Ainsi, la principale demande à Samuel Paty de s’excuser auprès de ses élèves et l’inspecteur référent-laïcité ose écrire dans son rapport que Samuel Paty a fait « une erreur »et qu’il « a froissé les élèves ». Il soutient ainsi la version mensongère de l’élève. Afin d’apaiser la communauté éducative, cet inspecteur demande donc au professeur de reconnaître sa « maladresse » et de prendre en compte le ressenti religieux de ses élèves dans son enseignement de la laïcité. Un comble.
Pris dans un engrenage pervers, Samuel Paty réalise parfaitement qu’on l’enferme dans une position où il ne peut jamais dire la vérité. Dans sa déposition au commissariat – étrangement négligée par le rapport officiel – Samuel Paty déclare : « Je n’ai commis aucune infraction dans le cadre de mes fonctions. » Là, il ne s’adresse pas au commissaire, qui n’a que faire de la pédagogie, mais à son administration.
Ce rapport révèle combien l’assassinat de Samuel Paty s’inscrit dans la politique du « pas de vagues » dénoncée par les professeurs…
Le « pas de vagues » consiste à protéger une structure administrative au détriment de l’individu. Pour preuve, dans le titre du rapport officiel, « Enquête sur les évènements survenus au collège du Bois d’Aulne avant l’attentat du 16 octobre », le nom de Samuel Paty ne figure pas, comme si l’attentat était dirigé contre l’établissement, et non contre le professeur. Ce document est conçu pour innocenter l’Éducation Nationale. Or, face à un chantage à la diffamation exercé par des islamistes, l’administration préfère procéder à un « accommodement raisonnable ». Le résultat de cette médiation pédagogique est que la violence islamiste est rejetée dans une catégorie que les rapporteurs appellent « l’impensable » – terme pour le moins surprenant. Si l’attentat était si impensable, pourquoi la principale demande-t-elle à Samuel Paty de se faire raccompagner par un collègue ? Est-ce à un collègue d’assurer la fonction de garde du corps ? Il est étrange que la coordination administrative tant vantée aboutisse à un résultat aussi fragile et hasardeux.
La politique de l’Éducation nationale contribuerait-elle à réduire la liberté d’expression et la laïcité ?
La hiérarchie a infantilisé Samuel Paty comme s’il n’avait pas compris la laïcité. Il faisait un cours sur la liberté d’expression et sa prévenance d’enseignant, très bien vécue par ses élèves dans les faits, a été retournée contre lui, pas seulement par les islamistes, mais également, à bien des égards, par sa hiérarchie.
En affirmant que Samuel Paty aurait choqué toute sa classe, l’intervention de l’inspecteur scellera son sort. Comment pédagogiquement en est-on arrivé là ? On a d’abord disqualifié l’autorité du professeur au profit d’un culte de l’élève, puis d’un culte du ressenti de l’élève, et finalement du ressenti religieux de l’élève. En sanctuarisant le ressenti religieux de l’élève, on enfonce le dernier clou dans le cercueil de la laïcité et de la liberté d’expression : sans le dire, on introduit le blasphème dans l’espace laïque.
Après l’attentat, la rectrice s’appuie sur le rapport de l’Inspection générale pour rassurer les professeurs : elle les enjoint à être « très fiers » de leur mission et leur promet, quant à elle, non pas de tout faire pour éviter qu’une telle tragédie se reproduise, mais « d’être à chaque fois plus efficace » (sic). Le décalage entre cette auto-congratulation administrative et la décapitation d’un professeur par un islamiste illustre à lui seul l’écart entre l’institution soumise aux éléments de langage et le réel.
Qu’avez-vous pensé des commémorations concernant l’assassinat de Samuel Paty ?
La classe politique a condamné Alexis Corbière, député mélenchoniste et ancien professeur d’histoire-géographie, qui, à propos des caricatures de Charlie Hebdo utilisées par Samuel Paty, a déclaré qu’un enseignant ne devait pas « choquer » les élèves. Or, personne ne réalise que c’est exactement ce qu’on a reproché à Samuel Paty lorsqu’il était encore en vie : il « a froissé ses élèves ». Bel exemple d’incohérence au moment même où on prétend lui rendre hommage. Sans compter la directive du ministère de l’Éducation nationale qui précise aux personnels que l’heure de commémoration au sein des établissements « n’a pas vocation à être un retour sur ce qui s’est passé il y a un an, ni une évocation de Samuel Paty ou de sa mémoire ». ●
Propos recueillis par Mélanie Déchalotte, Charlie Hebdo, octobre 2021.
J’ai executé un chien de l’enfer », vu par Nicolas Menut, Frédéric Schiffter et Dan Kaminiski.
Je crois deviner pourquoi j’ai mis tant de temps à oser lire le « rapport » de David Di Nota. Je me doutais que sa raison rendrait ma légèreté douloureuse ; qu’il appuierait là où ça fait mal ; et que mon insignifiante part personnelle de déni se trouverait pointée du doigt, de la main toute entière, de la main qui dénonce le déni intellectuel du chantage, des pièges et des malentendus du « respect ». Ce rapport produit le tour de force de restituer le résultat d’une enquête et d’assurer ce capitonnage entre zone individuelle de déni et construction institutionnelle d’un assassinat (parmi d’autres). Ce rapport est d’autant plus troublant que son agencement et son style sont redoutables.
Propos de droite? Non. La question est ridicule et reconduit le déni. Invitation faite à la gauche intellectuelle et politique comme aux raisons d’Etat : penser mieux, penser mieux.
D.K
Articles parus sur « Ta femme me trompe »
BENOÎT DUTEUTRE, Marianne, Sept 2013.
Par son titre à la Feydeau, son ironie et sa concision, David di Nota est un héritier de l’espirt français.
JEAN BIRNBAUM, Le Monde, Sept 2013.
Qu’on se le dise, les féministes ont tout faux. Les femmes et les hommes, ça n’a rien à voir, et un livre aujourd’hui vient le prouver de façon définitive. A peine était-il arrivé au journal que je l’exhibais devant l’équipe du « Monde des livres« . Sur sa blanche couverture se détachait ce titre choc : Ta femme me trompe. Les confrères s’esclaffèrent, les consoeurs point. Le soir, j’en faisais lecture à un couple d’amis. L’homme partit d’un rire gargantuesque, la femme partit tout court — telle une nymphe effarouchée. Dès lors, qui donc contestera les thèses philosophiques d’Eric Zemmour ? N’en déplaise aux bien-pensants, il existe un partage sexuel des tâches, à commencer par celle de l’herméneutique !
Clichés en cascade, emphase absurde, comparaisons foireuses : les lignes que vous venez de lire essaient de pasticher, mais en beaucoup moins drôle, le bref roman que David di Nota publie (pour de vrai) sous le titre Ta femme me trompe (Gallimard, « L’Infini », 152 p., 15, 90 €). Ce livre est un exercice d’ironie ravageuse, une parodie caustique, quelque part entre Voltaire et OSS 117. David di Nota colle aux mythologies du temps, depuis le train-train pornographique jusqu’à la littérature de gare. Son narrateur, journaliste employé par un quotidien de droite, se targue d’avoir le bras assez long pour bloquer la publication d’un article dans Le Monde. C’est un enquêteur intrépide, qui sait s’attirer la confiance d’un général en fonction comme celle d’une antique diva du X. Un reporter très à cheval sur les principes mais gentiment bidouilleur, n’hésitant jamais à « monter au créneau » afin de restaurer la paix mondiale.
David di Nota, naguère danseur à l’Opéra, épouse ici les pas d’un imbécile standard. Il colle à chacun de ses mouvements, rend justice à ses pirouettes. Si son roman touche juste, c’est qu’il ne charrie aucune fascination pour la sottise. Di Nota n’essaie pas de donner du sens à la médiocrité, encore moins de sonder ses mystères. Il se contente d’en mimer le triomphe tranquille, l’implacable simplicité.
JULIE BRUNET, Le Point, Sept 2013.
Après des oeuvres plus ouvertement politiques (J’ai épousé un casque bleu et Sur la guerre, mis au programme des concours des officiers de l’armée de l’air en 2008), David di Nota, romancier et docteur en sciences politiques, quitte le champ de bataille pour le terrain non moins miné des relations amoureuses. Dans Ta femme me trompe, un journaliste, qui ne manque jamais de passer déposer son linge chez sa mère, entame une relation sulfureuse avec la femme d’un inconnu dans le coma, croisé une seule fois en Italie dans une chambre d’hôtel, lors d’une scène cocasse de masturbation à plusieurs.
Le titre à lui seul résume bien le ton du livre, qui multiplie les très courts chapitres façon comic strip et où se mélangent trio amoureux pour le moins bouffon et traits d’esprit pleins d’humour. Dans un style indolent, David di Nota multiplie les réflexions et les théories absurdes, comme la sexualité féminine et masculine comprise à la lumière du Gradus, les procédés littéraires et de ses figures de style. On pouffe à toutes les pages face aux déboires d’un héros qui n’en est pas un et qui se laisse porter sans grande conviction là où les événements le mènent jusqu’à la déconfiture finale. « L’homme qui s’est fait avoir peut toujours choisir de rentrer chez lui« , conclut-il. Belle philosophie au pessimisme presque joyeux qui rappelle l’importance d’une résignation tranquille face à la bêtise et à l’absurde. Dans un monde où le mari cocu est souvent le plus heureux, rien ne sert de prendre le taureau par les cornes…
JERÔME LEROY, Causeur, Sept 2013
Il faut chercher pourquoi, une fois que l’on a refermé le court roman de David di Nota, nous éprouvons cette sensation d’avoir rêvé, mais d’un de ces rêves particuliers aux contours très précis et à la logique interne apparemment infaillible. Car après tout, si on résume le contenu de Ta femme me trompe, il s’agit d’une histoire assez simple. Un journaliste, le narrateur, part faire un reportage sur une actrice pornographique « reconvertie dans la défense du christianisme ». Il ne la rencontrera pas, mais se liera avec un homme qui l’invite à regarder des films de l’actrice en question dans sa chambre. Ensuite cet homme fait une crise cardiaque, reste à l’hôpital, et le journaliste devient l’amant de sa femme.
JEAN-LOUIS EZINE, Le Nouvel Observateur, Sept 2013.
Kafka se plaignait un jour que l’esprit des bouffons fut passé aux oubliettes. Pardon, cher Franz, tu n’as pas lu David di Nota.
This ironic title is indicative of the entire story:a sexual comedy told in a series of brief, numbered vignettes. The protagonist, a journalist whose affair with a married woman entails a number of strange and sometimes burlesque episodes, writes abouthis personal and professional adventures in a terse first-person narrative. Di Nota characterizes sexual relationships between men and women as banal and absurd.His‘theory of love’ reduces feminine sexuality to a figure of speech, the synecdoche, and masculine sexuality to another figure of speech,the zeugma. Although this simplification denies women and men a legitimate or respectable sexual identity, at least in this instance both sexes are treated equally.
This investigation into gendered identity is also evident in the relationships among the main character, the married woman, and her husband because it is sometimes unclear who manipulates whom and what role sex ultimately plays inbringing the people of this story together.These tactics,which only create confusion concerning the identities and relationships of the characters, add to the general sense of absurdity that di Nota develops throughout the novel. Adding to the confusion is the play between fiction and reality, between writing novels and doing journalism, and between telling the truth and dishing out “des histoires bidon”(82).The main protagonist also unabashedly confesses that he lies about the content of interviews he conducts and uses for his work, establishing the fact that he is not a reliable source of information. These moments of metafiction combined with the tenuous division between reality and fiction serve to distance the reader from the world of the narrative.Like its disconnected format,this novel underscores the potential for detachment and indifference in human relationships. Despite the seriousness of the content, the author’s style of humour noir paints mundane and sometimes painful moments with comedy. For example, the final vignette describes, in a matter-of-fact realistic tone, a moment in the day of the cuckolded husband. Although he has a minor role,the husband becomes a comical representation of the banality of sexual relations and the inevitable failure in human relationships. Ending the story with this random image is emblematic of the narrative, which is incoherent, succinct, and ridiculous. Di Nota’s novel, which can be read in one sitting, presents a cynical but entertaining string of episodes, which like life, puzzle and linger as fragmented memories.
Marylaura Papalas, East Carolina University (NC)







